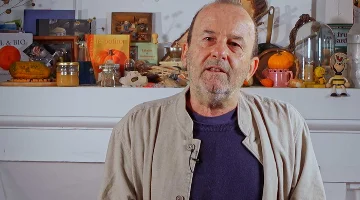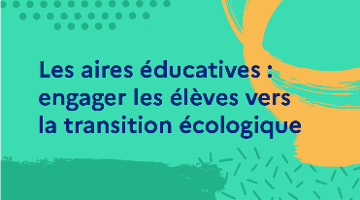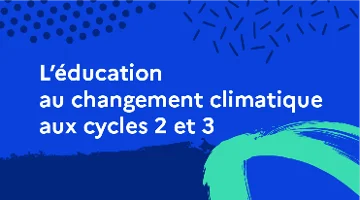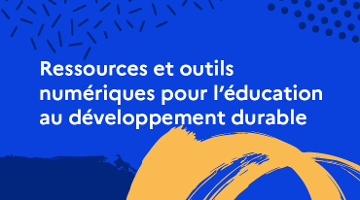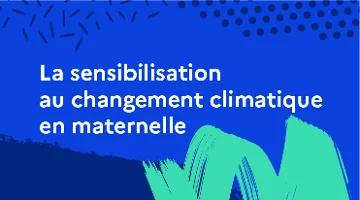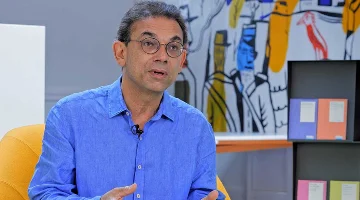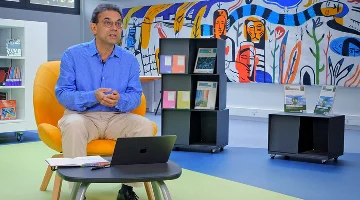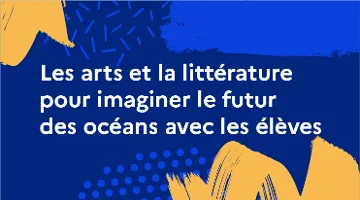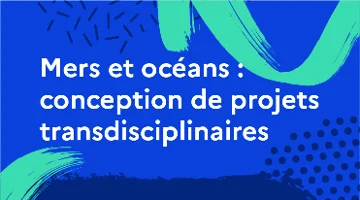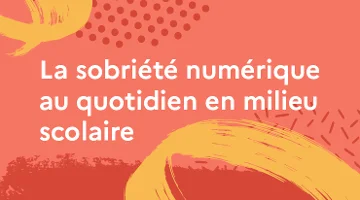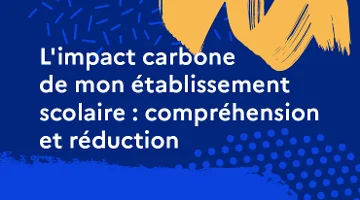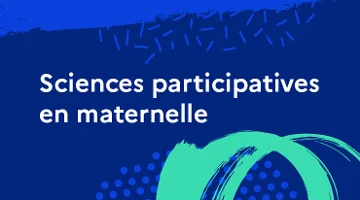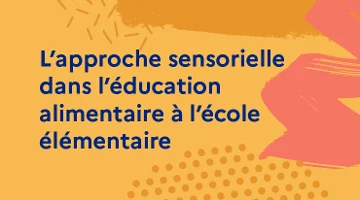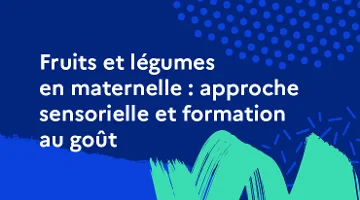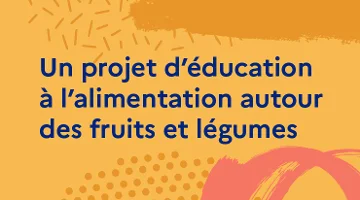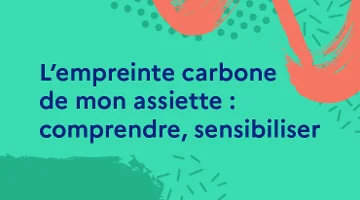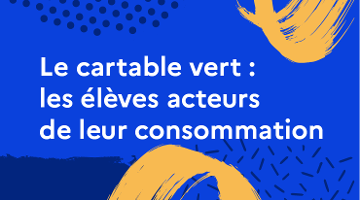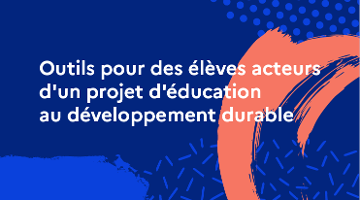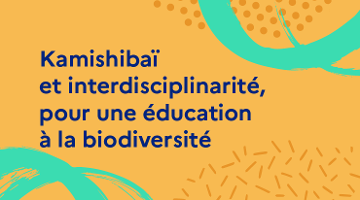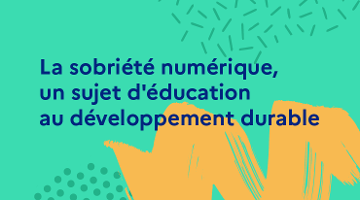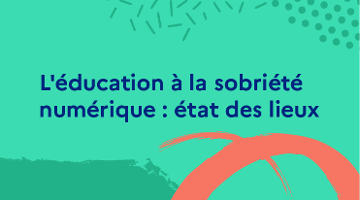Le rôle de l'école dans l'appropriation d'un nouveau rapport au vivant
Dans cette interview, Nathanaël Wallenhorst, maître de conférences à l'université catholique de l'Ouest (UCO), propose de repenser le rapport de l'humain avec la nature. Pour cela, il suggère de s'appuyer sur la médiation scientifique et les savoirs bioclimatiques produits notamment par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) ou l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques).
Intervenants
- Nathanaël Wallenhorst
Nathanaël Wallenhorst :
La nature, c'est un vieux terme, qui a plusieurs milliers d'années, qui veut dire quelque chose d'intéressant et précieux : il y a quelque chose d'autre que nous, il y a quelque chose d'autre que nous sur Terre.
Évidemment, il y a la vie humaine et puis la vie humaine en société et puis il y a les étendues, les océans.
Il y a aussi l'atmosphère et puis l'ensemble du vivant, les végétaux, les arbres, les animaux, etc.
La nature, ça regroupe tout cet ensemble-là.
Au cours de la modernité, on sait penser vraiment par différenciation de la nature.
Il y a les humains et la vie humaine en société, c'est différent de la nature.
Donc on a un grand couple notionnel nature culture ou nature société qui est pensé comme ça, comme fonctionnant de façon oppositionnelle, différenciée.
Alors, ce qu'il faut voir, là, maintenant, c'est que plus on avance au cours de...
déjà, dans la fin du XXe siècle et au cours de ce début du XXIe siècle, plus on se rend compte que, finalement, tout ça est fondé sur des erreurs, sur quelque chose, en tout cas, qui pose un problème dans cette supériorité et cette différenciation de la vie humaine d'avec tout ce qui n'est pas humain, le non-humain, qu'on a appelé la nature et puis que, de plus, on nomme le vivant.
Et même le vivant, il y a le vivant, évidemment, le vivant organique et puis il y a aussi tout le non-humain non organique.
De fait, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui que de penser, d'appréhender l'humain indépendamment de ses relations avec le non-humain ? À partir du moment où nous, comme humains, nous ne sommes plus en circulation, en transmission, en partage avec tout le non-humain, ça veut dire qu'on est mort, dead, ni plus ni moins.
Pourquoi ? On va prendre un exemple très simple, c'est-à-dire à partir de l'alimentation et puis à partir de la respiration, on est en permanence en train d'échanger et quelque chose en nous circule avec le non-humain qui nous permet, à un moment donné, de rester en vie.
Les limites actuelles qu'on constate dans ce dualisme nature culture, ça va assez loin, parce que derrière, ce sont les frontières de l'humain qui sont reconfigurées, repensées, réorganisées, disons qu'il y a du trouble dans la définition de l'humain aujourd'hui.
Admettons qu'on mange un sandwich et en mangeant le sandwich, j'intègre des atomes de carbone.
Et puis après je respire, je suis en vie, donc je partage du dioxygène avec du dioxyde de carbone.
Et puis l'atome de carbone, à un moment donné, il participe à la constitution chimique de l'atmosphère et du CO2 que j'émets.
Et il se trouve que cet atome de carbone, au cours de sa vie, de ses nombreuses vies trépidantes, eh bien, il sédimente sous la forme d'un grain de sable.
Alors moi, je suis qui ? Je suis le sandwich, je suis moi, là, voilà, je suis la constitution chimique de l'atmosphère ou est-ce que je suis le grain de sable ? On voit bien que, de fait, il y a... la réponse n'est pas si simple et à cet endroit, on voit bien qu'on ne peut pas appréhender l'humain, on ne peut pas nous penser nous-mêmes, indépendamment de cette grande circulation à laquelle on participe.
Aujourd'hui, pour penser notre rapport au vivant, on a besoin d'une médiation et cette médiation, c'est la médiation scientifique.
On a affaire à des décennies particulièrement intenses de formalisation d'un consensus scientifique pluridisciplinaire et international, tant sur le climat que sur la biodiversité.
On peut même parler de savoir bioclimatique, savoir bioclimatique, dont la synthèse est produite bien évidemment par le GIEC, dont on entend parler régulièrement, etc.
mais aussi par l'Ipbes, une plateforme intergouvernementale, pour formaliser un consensus autour des savoirs relatifs à la biodiversité et puis voir la façon dont nous, comme sociétés humaines, nous pouvons lutter contre l'emballement climatique et puis lutter contre l'effondrement des écosystèmes.
Alors le problème, c'est que ces rapports, pour l'instant, sont accessibles en anglais.
Et alors, face à ce problème, j'ai presque envie de dire ce scandale, d'un manque d'accessibilité de ces savoirs pour les Français, on a tout un tas d'organisations, d'instances, etc.
qui ont préparé des petits... des résumés particulièrement bien écrits, en français, des pédagogues les ont travaillés, malaxés pour que ces savoirs-là soient accessibles.
L'Office for Climate Education, par exemple, qui a une terminologie, un nom anglais, mais qui produit des rapports en français, a fait différentes choses comme ça particulièrement accessibles ou les Saventuriers, aussi, qui ont proposé différentes fiches pédagogiques pour comprendre l'état des lieux bioclimatiques.
Pour penser ce qui se passe aujourd'hui de façon très singulière dans le rapport au vivant, on a besoin de la médiation scientifique, il y a un article particulièrement intéressant qui est paru en 2011, par Barnowski, et qui nous dit : peut-être que nous serions entrés dans une sixième extinction de masse ; c'est-à-dire il reprend l'histoire du vivant sur la Terre qui a connu cinq épisodes d'extinction de masse caractérisés par une perte de 75 % de la biodiversité en moins de 2 millions d'années, alors que nous, homo sapiens, on vient tout juste de débouler, il y a 0,35 millions d'années.
Et ce qu'il nous dit, c'est, avec ses collègues, que d'ici quelques centaines d'années, nous pourrions voir advenir une extinction de masse du vivant du fait de nos relations de destruction à l'égard du vivant.
Et puis, il y a un autre auteur, un biologiste mexicain, Ceballos, qui, en 2017, a proposé une étude extrêmement intéressante où il est venu rompre avec le modèle de l'extinction de masse proposé par Barnowski en nous disant : mais non, en fait, ce qui arrive là est complètement inédit, n'est jamais encore advenu dans l'histoire du vivant, nous avons affaire à une annihilation biologique sans précédent.
Il a regardé d'autres indicateurs, non pas l'extinction des espèces, mais l'extinction des populations, c'est-à-dire les aires de répartition des espèces et il arrive à cette conclusion d'une forme de fulgurance, de percussion de la vie humaine en société à l'égard du vivant, bien évidemment médiés nos artefacts technologiques et puis, galvanisés par la puissance économique et financière.
Dans la thématique « Éduquer à la transition écologique et sociale »